Les eaux de boissons
1. Les eaux de boissons
1.1
Activité
Lire le doc1 p 100 et répondre aux questions
Question 1:
La composition d'une eau "minérale" en minéraux et oligo-éléments est constante. Celle
d'une eau de source ne l'est pas.
Question 2:
Une eau de source est naturellement saine ; elle n'a pas besoin d'être
traitée avant consommation.
Question 3:
l'eau de Contrexéville ou l'eau d'Hépar
1.2
Les différentes eaux de boisson
On distingue 3 catégories
d’eaux :
* Eau
du robinet : elle provient des eaux de surfaces
ou des
eaux souterraines. Elle
subit des traitements
chimiques
avant d’être consommée.
* Eau
de source : elle provient des eaux souterraines.
Elle est
embouteillée sur le lieu de captage.
Elle ne subit pas
de traitements
chimiques.
* Eau
minérale : elle provient également des eaux souterraines
sans traitement préalable. Sa composition en minéraux est
constante
Seules l’eau du robinet et les eaux
de source sont tenues de respecter les critères de potabilité
définis
par les pouvoirs publics.
2. Analyse des eaux
Quelles sont les indications portées sur une
étiquette d’eau minérale ?
http://www.ademe.fr/partenaires/Boues/Pages/f14.htm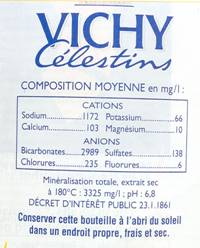
2.1
Le pH
C’est un nombre qui renseigne sur l'acidité de
l’eau.
Le pH se mesure avec un pHmètre.
L’eau est :
| Acide |
pH < 7 |
| Basique |
pH >7 |
| Neutre |
pH = 7 |
Dans l’eau de Vichy Célestins, pH= 6,8. Cette eau
est légèrement acide.
2.2
Le résidu sec
Dans l’eau de Vichy Célestins, l’extrait
sec : 3325
mg/L
Le résidu sec est la masse
de substances solides
contenues dans un litre d’eau après chauffage à 180 °C et évaporation.
Plus la masse de ce résidu est importante et
plus l’eau
est minéralisée.
2.3 Les sels minéraux
On les trouve sous la forme d’ions
dans l’eau.
1) Activités
Compléter le tableau en vous
aidant de l’étiquette
de l’eau de Courmayeur p 108
| ion |
formule |
ion |
formule |
| calcium |
Ca2+ |
chlorure |
Cl- |
| sodium |
Na+ |
fluorure |
F- |
| magnésium |
Mg2+ |
bicarbonate |
HCO3- |
| potassium |
K+ |
|
|
Lire
le document p111, puis comparer les apports
journalier recommandés pour le fer, le zinc…avec les quantités de
sodium, calcium….présents dans l’eau de Vichy Célestins ou
l'eau de Courmayeur
Les apports
journalier recommandés pour le fer, le zinc sont très faibles
(de l'ordre du mg/ jour).
Les quantités d'ions calcium, magnésium (présents dans 1 L d'eau) sont
beaucoup plus importantes!!
2) Conclusion
Parmi
les sels minéraux, on distingue les macroéléments
et les oligo-éléments:
* Macroélément :
les éléments qui sont apportés dans des proportions appréciables
(relativement importantes)
* Oligoélément :
les éléments qui sont apportés dans de faibles proportions.
La quantité d’ions présents dans une eau est
déterminée par dosage.
Chaque eau a une composition en sels minéraux
différentes soit une minéralisation différente.
Remarque :
lorsque la quantité d’un oligoélément
est insuffisante, il y a carence.
Ce manque peut provoquer des maladies + ou –
graves .
-
carence
en fer : anémie
- carence
en zinc : retard de croissance
2.4 La dureté
La dureté correspond
à la quantité d’ions
calcium Ca2+ et
magnésium Mg2+ dissous dans l’eau
La dureté d’une eau ou titre
hydrométrique TH s’exprime en degré français (°F) .
Une eau de consommation courante a
une dureté de 15°F .
Conséquence d’une eau trop
dure :
- savon ne mousse
pas : lavage moins
efficace
donc utilisation de plus de lessive .
- formation de tartre:
augmentation de l’entartrage
des cafetières ( dépôt blanc sur la vaisselle)
3. Normes de potabilité
L’eau est un aliment très surveillé
qui fait l’objet de fréquentes
analyses.
Actuellement, en France, 56
critères définissent les normes de potabilité de l’eau.
Celle-ci doit
être limpide, sans odeur ou goût désagréable. Elle ne doit pas contenir
d’organismes pathogènes ( microbes), ni de substances toxiques comme le
plomb, le mercure , des pesticides.
L’eau doit être en
conformité avec les paramètres physico-chimiques et respecter les
concentrations maximales de substances, dont la présence est tolérée à
faible dose, mais qui peuvent s’avérer dangereuses au delà d’un certain
seuil, telle les fluorures, les nitrates….
(Exemples de
maladies crées par la présence de certains éléments : le
plomb : saturnisme )
ex 2 + 3 p 107 ( voir tableau des normes de potabilité p 105)
Remarque : une eau
minérale ne satisfait pas forcément aux critères de potabilité…Une eau
de robinet
et une eau de source doivent obligatoirement y satisfaire…
document : 3
eaux minérales d'Ardèche
4. Les traitements de l’eau
4.1
Le cycle naturel de l'eau
voir animation
(un peu lente, mais très bien faite!)
 (d'après cnrs)
(d'après cnrs)
Sous l'action du soleil, l’eau s'évapore :
passage du liquide au gaz ( = vapeur d'eau)
Cette vapeur s’élève, se refroidit. La vapeur d'eau se condense.
De minuscules petites gouttes d’eau se regroupent : formation
des nuages …
Le vent pousse les nuages au–dessus des terres, où la température se
refroidit…
L’eau des nuages retombe alors (précipitations)
sous forme liquide (pluie) ou solide (neige).
L’eau s'écoule
à la surface de la terre (ruissellement) et forme les
rivières....ou s’infiltre
sous la terre et forme des réserves d’eau souterraines (nappes
phréatiques).
L'eau retourne ensuite à la mer.....Et le cycle recommence !
4.2 Eau douce
Réserves d’eau douce sur la terre ( elles sont très limitées
)
2,5% contre 97,5% pour l’eau salée. (illustration)
Seule une partie des réserves d’eau douces est facilement disponible
pour assurer notre alimentation. (illustration)
Près
de la moitié de la population mondiale souffre de pénurie
d’eau.
4.3 Pour obtenir de l'eau potable...
voir animation
(un peu lente, mais très bien faite!)
 (d'après: eau de france)
(d'après: eau de france)
L'eau prélevée dans une rivière est d'abord débarrassée des grosses
particules en passant sur une grille
puis elle passe ensuite dans des tamis à mailles fines retenant les
déchets les plus petits.
On ajoute un coagulant pour rassembler en flocons les déchets
encore présents dans l'eau. Ces flocons, plus lourds que l'eau, se
déposent au fond du bassin de décantation
et 90 % des matières en suspension sont ainsi éliminées.
L'eau traverse un filtre,
lit de sable fin et/ou un filtre à charbon actif.
L'eau est désinfectée
grâce à l'ozone
qui a une action bactéricide et antivirus.
On ajoute du chlore
à la sortie de l'usine de production et sur différents points du réseau
de distribution afin d'éviter le développement de bactéries et
maintenir la qualité de l'eau tout au long de son parcours dans les
canalisations.
4.4 Traitement des eaux usées
voir animation
(un peu lente, mais très bien faite!)
 d'après Ademe
d'après Ademe
Ce traitement s'effectue dans une station
d'épuration.
Tout d'abord, on enlève les éléments les plus grossiers : le dégrillage consiste
à faire passer les eaux usées au travers d’une
grille . Après nettoyage des grilles par des moyens
mécaniques, manuels ou automatiques, les déchets sont évacués avec les
ordures ménagères. Le tamisage,
qui utilise des grilles de plus faible
espacement, peut parfois compléter cette phase du prétraitement.
Le dessablage
et le déshuilage-dégraissage
consistent ensuite à faire passer l’eau dans des bassins :
les sables se dépposent et les graisses flottent. Les sables sont
récupérés par pompage alors que les graisses sont raclées en
surface.
On ajoute ensuite des agents coagulants
et floculants .
Les amas de particules ainsi formés, ou “flocs”, peuvent être séparés
de l’eau par décantation
ou par flottation).
Ces traitements permettent d’enlever jusqu’à 90 % des
matières en suspension. La pollution dissoute n’est que très
partiellement traitée.
Les traitements biologiques,
sont indispensables pour extraire des eaux usées les polluants dissous,
essentiellement les matières organiques.
Ils utilisent l’action de micro-organismes capables d’absorber ces
matières.
Remarque : de plus en
plus, on utilise des stations d'épuration "naturelles" à roseaux...( par exemple, en
Ardèche: à Montpezat sous Bozon ou à Saint Thomé...)
4.5 Autres traitements
a) La distillation
On porte à ébullition l’eau, la
vapeur qui se dégage contient uniquement de l’eau pure. Il suffit de
condenser cette eau.
Remarque :
cette eau,
chimiquement pure, n’est pas pour autant potable, car elle est
dépourvue
de minéraux indispensables.
b) Rendre une eau moins dure
On utilise une résine
échangeuse
d’ions. Les ions calcium et magnésium (responsables de la dureté de
l’eau ) sont échangés par d’autres ions ( ions sodium ) contenus dans
la résine.
( c'est pour cela que
l'on met du sel dans un lave-vaiselle!)
c ) Dessalement de l’eau de
mer
Les réserves
en eau douce de la planète étant limitées, le dessalement de l’eau de
mer est sans doute une réponse pour le futur.
Vidéo sur le dessalement de l'eau de mer
Inconvénient : procédés coûteux seulement à la portée de pays
riches.
pour plus d'infos....
http://www.eaumineralenaturelle.fr/#
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/potable/sourceMin.html
http://www.cieau.com/accueil.htm
http://sciencesphysbayen.wifeo.com/chimie-premire-l.php
Compléments
: L'Ardèche est le pays de l'eau....
Composition de l'eau
minérale de Vals :
|
Composition en mg/l
|
|
calcium = 45,2
|
magnésium = 21,2
|
sodium = 453
|
|
sulfate = 38,9
|
chlorure = 27,2
|
potassium = 32,8
|
|
nitrate = < 1
|
bicarbonate = 1403
|
ph = 6,2
|
Composition de l'eau minérale du Vernet
( captée à Prades)
|
Composition en mg/l
|
|
calcium = 33,5
|
magnésium = 17,6
|
sodium = 192
|
potassium = 28,7
|
|
fluor = 1,3
|
bicarbonate = 734
|
sulfate = 14
|
chlorure = 6,4
|
|
nitrate = < 1
|
nitrite = < 0,01
|
phosphate = < 0,05
|
résidu sec = 675
|
Composition de l'eau minérale de Ventadour
( captée à Meyras)
Eau décantée , filtrée et renforcée au gaz de la
Source " Source du Pestrin "
|
Composition en mg/l
|
|
calcium = 43,5
|
magnésium = 11,5
|
sodium = 15,5
|
|
sulfate = 4,8
|
chlorure = 3
|
potassium = 1,8
|
|
bicarbonate = 244
|
nitrate = 0,05
|
silice = 45,7
|
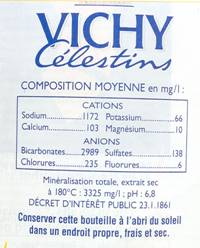
 (d'après cnrs)
(d'après cnrs) (d'après: eau de france)
(d'après: eau de france) d'après Ademe
d'après Ademe